![]()
Extrait de Gouverner par le Bien commun
« Tel est le funeste destin de l’Europe : ayant cessé de craindre l’homme, nous avons cessé de l’aimer, de le vénérer, d’espérer en lui et même de le vouloir. Désormais le spectacle qu’offre l’homme fatigue. Qu’est-ce qu’aujourd’hui que le nihilisme, sinon cela ? (…) Nous sommes fatigués de l’homme »
Nietzsche« La généalogie de la morale », Gallimard,, p. 44
Le nihilisme n’est pas en soi une mauvaise chose. Expérience du tragique et du vide de la vie humaine, il peut être un fondateur au sens de l’expérience de l’absurde chez Albert Camus. Découvrir qu’il n’y a rien et que le monde est vide et sans sens, que nous sommes responsables de nos buts et de leur atteinte, que le sens ne nous est pas donné, mais que ce qui nous a été donné c’est la capacité à donner du sens à notre vie, est une expérience du tragique. Et là « dans un acte héroïque, l’homme tragique, précisément parce que tout est obstacle, souffrance et abîme vertigineux (et non point bien que tout soit souffrance) bande sa volonté et tend ses facultés : puisque tout est horrible et absurde, précisément il agira » (« Le tragique créateur, Qui a peur du nihilisme ?” Jacqueline Russ, Armand Colin, 1998)
Elle est fondatrice car c’est une expérience de la liberté: l’homme peut le meilleur autant que le pire. Le XIX° siècle, en bouleversant les cadres des sociétés traditionnelles, vit la naissance du nihilisme moderne qui allait prendre diverses formes: celle du nihilisme actif, furieux de découvrir que là ou l’on pensait qu’il y avait quelque chose il n’y a rien et voulant faire de cette découverte une nouvelle fondation, et celle du nihilisme passif contemporain, celui du dernier homme dont Nietzsche annonçait l’arrivée dans Ainsi parlait Zarathoustra qui se contente de ne plus croire à rien après la mort de Dieu et de vivre sa petite vie dans la passivité tranquille du triptyque « santé, sécurité, confort ».
Un point commun à ces variantes du nihilisme: la volonté de puissance. La volonté de puissance, c’est le refus de l’homme faillible et libre amené à délibérer sur les buts qu’il veut se donner, et le contenu qu’il veut donner à sa liberté. C’est le refus de la nature, du droit naturel, pour l’affirmation de la volonté de l’homme de se façonner indépendamment de toutes les contingences et de toute norme exogène liée à son humanité. Vouloir à tout prix de peur de subir, la volonté comme unique objet de la volonté, telle est la volonté de puissance. Sa forme la plus radicale fut le nazisme, refus régressif de la modernité instituée par les lumières et l’Aufklärung pour la quête d’un surhomme mythique, mais également le communisme qui, s’il n’était pas nihiliste dans ses motivations le fut dans ses moyens et dans ses fins. Les formes “soft” de la volonté de puissance sont aujourd’hui l’hédonisme agressif du “jouir sans entraves” qui est le refus de la contingence pour la quête d’un monde sans contraintes49.
Mettre rien là où il y a quelque chose
“Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » A cette éternelle interpellation de Leibniz, les nihilistes ont leur réponse : Puisque la connaissance du monde et de l’homme nous montre qu’il n’est pas parfait, c’est donc que toute perfection ne peut être de ce monde. Puisque le sens ne nous est pas donné, tout sens ne peut être qu’une illusion que le nihiliste se doit de détruire. Plutôt rien que quelque chose d’imparfait !
Le subjectivisme radical, ou le triomphe du “je” sur le “nous”
C’est en 1967 que Raoul Vaneigem publia ce qui allait devenir le manifeste idéologique des trente piteuses : le « traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations ». L’idée fondamentale du « Traité » est le subjectivisme radical ou l’opposition irréductible entre ce que Louis Dumont appelle l’auto-nomie (les normes que je suis moi-même capable de me fixer) et l’hétéro-nomie (les normes qui me viennent des autres, c’est-à-dire du corps social). Le Traité est explicitement nihiliste, d’un nihilisme actif qui cherche la révolution dans la démonstration que toute idée, toute institution est une aliénation et une mutilation de la créativité. Le nihilisme actif est présenté comme un point de passage obligé au delà duquel peut naître la révolution par la destruction de tous les conformismes : « Les nihilistes sont, en dernier ressort, nos seuls alliés. Ils vivent dans le désespoir du non-dépassement ? Une théorie cohérente peut, leur démontrant la fausseté de leur vue, mettre au service de leur volonté de vivre le potentiel énergétique de leurs rancoeurs accumulées… Nihilistes, aurait dit Sade, encore un effort pour devenir révolutionnaires ». Niant toute hétéronomie, le subjectivisme rejette toute transcendance et tire toute vérité de l’instant -« Il y a plus de vérité dans vingt-quatre heures de la vie d’un homme que dans toutes les philosophies »- et proclame la volonté de puissance du sujet : « Une réalité sur laquelle je n’ai pas de prise, n’est-ce pas le vieux mensonge remis à neuf, le stade ultime de la mystification ? ».
La question de la volonté de puissance chez Nietzsche reste controversée. Son dernier ouvrage qui porte ce titre est posthume et a en fait été manipulée par sa sœur Elisabeth, fortement engagée à l’extrême-droite qui allait faire de l’œuvre de Nietzsche une caution de l’idéologie nazie de la “race des seigneurs”. Nietzsche n’a pas été un philosophe de la mort mais un philosophe de la vie, quand bien même sa philosophie a pu être détournée (voir “Nietzsche contre le nihilisme”, le magazine Litteraire, janvier 2000).
Nous donnons ici à volonté de puissance le sens du refus de l’homme faillible et mortel. La seule source de vérité ne peut résider que dans la spontanéité et la créativité individuelle. Aucun « nous » ne peut exister en dehors de l’addition des « je » libérés de toutes contraintes: « Rien ne m’autorise à parler au nom des autres, je ne suis délégué que de moi-même et, pourtant, je suis constamment dominé par cette pensée que mon histoire n’est pas seulement une histoire personnelle mais que je sers les intérêts d’hommes innombrables en vivant comme je vis et en m’efforçant de vivre plus intensément, plus librement ».
Rédigé en un langage révolutionnaire à coups de dénonciation de la « bourgeoisie » et des « conformismes », le traité de M. Vaneigem – qui fit depuis toute sa carrière comme fonctionnaire de l’Etat belge- allait devenir la bible des libertaires spontanéistes dont le pouvoir idéologique allait s’affirmer en France à partir de 1970 : Vive le « je » donc, à bas le « nous », source de toutes les oppressions. Les libéraux et les libertaires allaient trouver là les habits neufs de leur alliance pour la domination de la société et du monde. Toute expression d’un vouloir vivre collectif, école, Etat, loi, famille, tout mythe fondateur républicain devenait une cible. La première sera l’histoire et le morceau de choix la Résistance et l’antifascisme, la seconde ce qui assure la cohésion sociale donc l’école et la clé de voûte le post-modernisme qui apportait la « théorie cohérente » annoncée par Vaneigem.
“Tout est suspect”: le flirt logique des gauchistes et du révisionnisme
« Sur les « faits », ordres d’Hitler, chambres à gaz, chiffres (dont j’affirme qu’à ce jour ni ceux des historiens officiels, ni ceux des « révisionnistes » ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse)…, je ne suis pas loin de penser que les révisionnistes ont raison; (…) Si l’on peut douter de l’existence des chambres à gaz, c’est qu’elle ne tient que sur des récits de témoins (aveux, mémoires, témoignages au procès) et que ces récits sont contradictoires en eux-mêmes et entre eux… ».
Extrait de “Intolérable intolérance”, de Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Cette publication date de 1981, mais à aucun moment les frères Cohn-Bendit ne sont revenus sur leur soutien à Faurisson au nom de la liberté d’expression. A l’occasion des élections européennes de 1999, les révisionnistes se félicitent de ce que leur courant de pensée soit représenté par les frères Cohn-Bendit Le Monde du 15-16 novembre 1998 note en effet, p. 9: que Daniel Cohn-Bendit “Pour sa campagne européenne, il a promu son frère “conseiller politique”, malgré les dénis des dirigeants de l’avenue Parmentier. Passé par Génération Ecologie, en 1988, ce militant arrive chez les Verts sur le tard, avec Noël Mamère, traîne pourtant quelques casseroles sonores depuis que, en 1980, il a défendu (au coté d’Eric Delcroix, avocat de Faurisson, un temps conseiller régional FN de Picardie, organisation qu’il quitté), dans Intolérable intolérance, aux éditions de La Vieille Taupe, la liberté de recherche pour les historiens révisionnistes. “Mon frère a toujours été un libertaire radical. Quand on en arrive à un certain niveau de contradiction, on peut trébucher. “, justifie [Daniel Cohn-Bendit]“. (extrait de “Les Cohn-Bendit et le révisionnisme”, AARGH,) 52 “P. Vidal-Naquet “les assasins de la mémoire”, Seuil 1995. De lui les révisionnistes disent: “Pierre Vidal-Naquet est un minable. Dans un pays où le recrutement des universitaires se fait uniquement par cooptation, on ne s’étonnera pas, à ce titre, de le trouver “directeur d’étude” dans une institution ad hoc. Jamais il ne travaille dans son domaine, la Grèce ancienne. Jamais il ne collabore à la recherche historique, sa discipline nominale. Il est trop occupé à étouffer l’histoire pour soigner la “mémoire”, c’est-à-dire le rançonnement de tout ce qui bouge par ses compères des associations.”. Curieux libertaires qui veulent que l’ordre règne et que les historiens se cantonnent à leur strict discipline d’origine. Rappelons que Pierre Vidal-Naquet échappa de justesse à l’arrestation par les allemands à Bordeaux, étant en retard de l’école et put être prévenu de l’arrestation de ses parents qui furent exterminés.
Comment le théoricien gauchiste Jean-Gabriel Cohn-Bendit en vient-il ainsi à prendre la défense des révisionnistes? Pierre Vidal-Naquet a analysé ce phénomène.A l’origine on trouve des archéologues du marxisme, disciples de Bordigua, un marxiste italien des années trente, passé, comme Pierre Guillaume, par l’Internationale situationniste où il cotoya Vaneigem, et qui allait fonder le groupe « La vieille taupe », devenu le temple du révisionnisme. Quel est l’enjeu pour eux? Torpiller la « démocratie bourgeoise » qui se refait une vertu de sa lutte contre le nazisme. Quel est l’argument? l’utilisation de l’holocauste comme justification a posteriori des politiques, dont le sionisme.
Il est évident que l’utilisation de l’holocauste a posteriori pour se faire une virginité a peu de frais a été et est encore une activité rentable pour justifier des actes peu justifiables dans le présent (comme la politique d’annexion d’Israël) ou dans le passé (comme la lâcheté des démocraties devant le nazisme ou le stalinisme). Eviter que l’histoire ne serve d’alibi est le travail et la mission de tout historien en appliquant la méthode historico-critique. Mais tel n’est pas le souci des révisionnistes et des libertaires qui les soutiennent.
“Ce que je me refuse à faire, y compris aux néo-nazis, je ne suis pas prêt à accepter qu’on le fasse à des hommes comme Rassinier ou Faurisson dont je sais qu’ils n’ont rien à voir avec eux, et le procès intenté à ce dernier me rappelle plus l’inquisition qu’une lutte contre le retour du pire“. G. Cohn-Bendit “Question de principe”, Libération 5/3/79
L’objectif est de montrer que la démocratie n’étant pas parfaite, ou à tout le moins, pas conforme aux mythes qui se sont forgés après guerre, elle ne peut être que coupable, et donc à mettre que dans le même sac que le nazisme et le stalinisme.
On recourt pour cela à une analyse purement technique des faits: on n’a pas de sources écrites, donc les faits n’existent pas! Les témoignages sont contradictoires, donc les faits n’existent pas! Si l’on suivait la « méthode historique » des révisionnistes lorsque l’on est en présence d’une évaluation contradictoire du nombre de manifestants par les organisateurs et par la police, on conclurait, du seul fait de cette divergence, que la manifestation n’a pas eu lieu. Le raisonnement devient particulièrement monstrueux dans le cas du génocide, puisque toute la politique des nazis a consisté à détruire toute source et toute trace matérielle et que la logique de l’univers concentrationnaire était bâtie sur un « comment » édulcoré évitant, au travers d’un langage bureaucratique neutre, toute évocation du « quoi », de l’extermination, au profit d’une logique purement technique de bon fonctionnaire.
Dernier argument: la liberté d’expression. Les révisionnistes se sont en effet tissés un manteau de vertu des poursuites dont ils furent l’objet, et c’est pour défendre la liberté que les Cohn-Bendit sont venus à leur secours54. Il est évident que l’interdiction ne résout rien et qu’une lecture commentée de « Mein Kampf » dans les écoles serait le meilleur moyen de démonter l’attrait malsain qu’exerce la mythologie nazie. Mais telle n’est pas la préoccupation de nos héros qui, une fois devenus les hérauts du nouvel ordre moral, ont soutenu le vote de la loi Gayssot qui précisément interdit l’expression du révisionnisme, leur apportant sur un plateau des habits neufs de victimes. Non, le but des frères Cohn-Bendit est de montrer que la démocratie, et surtout la République, étant un régime imparfait pour des hommes imparfaits, où la mythologie diverge nécessairement de la rigueur historique, est de ce seul fait aussi mauvaise que les autres régimes. Ainsi se renforce en politique le relativisme obsessionnel, au nom du « mettre rien là où il y a quelque chose »
La destruction de l’enseignement par le pédagogisme
Philippe Meirieu fut le gourou de la politique scolaire de Claude Allègre et auteur d’un ouvrage qui résume son projet « L’Ecole ou la guerre civile ». Lointain écho aux théories de Vaneigeim : la crise de l’école serait essentiellement due au désir des enseignants d’enseigner ! (« L’Ecole ou la guerre civile », Ph. Meirieu et Marc Guiraud, Plon 1997. Pour une présentation des théories de Ph. Meirieu, voir Denis Kambouchner “Une école contre l’autre », PUF 2000)
Ce désir serait l’expression de leur libido, elle même produit des « obscures vengeances » qui justifient la vocation de l’enseignant. Esclave de sa libido, l’enseignant cède à ses pulsions malsaines et ne peut s’empêcher de vouloir enseigner et promouvoir sa discipline aux dépens d’une éducation globale de l’enfant. Certes, rien n’est jamais totalement faux dans les propos de Philippe Meirieu, mais tout procède de réductions et d’oppositions primaires entre transmission du savoir et éducation de la personne. Que l’enseignement traditionnel, centré sur l’acquisition des savoirs, ait négligé les savoir-faire, cela est vrai. Que les savoirs soient cloisonnés et qu’il faille relier les disciplines, cela est vrai.
Mais le projet des « modernistes » -au rang desquels on ne s’étonnera pas de retrouver Jean-Gabriel Cohn-Bendit animateur du « lycée autogéré » de Saint-Nazaire– est de mettre en cause l’existence même des savoirs par une confusion stupéfiante entre savoir et information[1]: internet donne accès à l’information, donc en navigant sur internet l’élève peut construire lui-même ses savoirs. Finis donc les profs d’histoire et de philo, place aux animateurs qui aident au maniement de la souris. Relativisme cognitif radical qui fonde la mise en cause par Philippe Meirieu du projet de l’instruction publique, laïque et obligatoire: la volonté d’intégrer, par l’école, les enfants dans une citoyenneté commune: « Jules Ferry préconisait donc d’éradiquer ce qui sépare les hommes au profit de ce qui les unit » accuse-t-il. Et de promouvoir une obsession qui est au cœur de l’idéologie contemporaine: celle de l’hétérogénéité.
Depuis les années 70, la constante des réformes est d’être purement technique l’enseignement de toute norme sociale devenant sulfureux- avec la mise en place du collège unique. L’école primaire perd la mission de préparer les élèves à la vie et de les doter de « tout ce qu’il n’est pas permis d’ignorer » pour devoir se contenter de les conduire en sixième. L’école mène au collège qui mène au lycée qui mène à l’université qui…?. Les autodénommées « sciences de l’éducation » ne sont qu’une succession de processus sans buts qui sont l’expression du relativisme dans l’enseignement : puisqu’il n’y a pas de vérité, il n’y a pas de culture – il y a des vérités et des cultures – donc ce qui compte ce sont les « compétences », soit des savoir-faire instrumentaux. L’issue est connue: absence d’acquisition des fondamentaux à l’entrée en sixième, développement de l’échec scolaire et de formes perverses de compétition (reconstitution de filières selon le choix de la 1° langue étrangère, le lieu d’habitation..) qui assurent la reproduction des inégalités sociales.
La cause en est la doctrine de l’hétérogénéité, dénoncée par Liliane Lurçat[2], qui assimile l’égalité des droits à l’instruction à l’égalitarisme entre les personnes[3], qui nie les différences entre les projets individuels[4] ce qui revient alors à « imposer à tous les même vide intellectuel aux effets barbarisants. La massification de l’enfance et de la jeunesse ainsi réalisée produit partout des phénomènes semblables »[5]. Ces pulsions tournent à l’obsession chez les nouveaux bien-pensants qui franchissent le pas en assimilant enseignant et pédophile. Martin Rey – (“La chute de la maison Ferry”, Arlea, 1999)- souligne l’offensive déclenchée contre les enseignants à l’occasion de la lutte contre les réseaux pédophiles. Seuls les noms des enseignants sont rendus publics, au mépris de la présomption d’innocence. Bernard Hanse, accusé à tort de pédophilie par un enfant de treize ans, met fin à ses jours. Devant la rétractation de l’enfant, Mme Ségolène Royal répond “l’enfant a très bien pu se rétracter sous la pression des adultes”. “On ne pouvait rêver mieux que la pédophilie pour ruiner définitivement la nécessaire confiance entre élèves et enseignants”, conclut Martin Rey.
Généralement, les « modernistes » des trente piteuses veulent libérer la France de ses archaïsmes en recourant avec dix ans de recul à des recettes qui ont déjà échoué aux Etats-Unis. Là, c’est soixante-dix ans. Les sciences de l’éducation y apparaissent dans les années vingt comme réponse à la massification de l’enseignement qui pose un véritable problème : celui de la multiplicité des projets scolaires dans un enseignement conçu jusqu’alors pour une population scolaire homogène. Or, aller à l’école a une valeur en soi – par la socialisation de l’enfant- qui se traduit en biens collectifs : qualité de la main-d’œuvre, santé publique, citoyenneté. Reconcevoir les enseignements de manière à ce qu’ils prennent en compte la diversité des projets scolaires revenait à reconnaître cette diversité, mais cela contrevenait à l’idéologie égalitariste dominante : la relation hiérarchique maître-élève ne cadre pas avec l’idéal du self-made man maître de son destin[6].
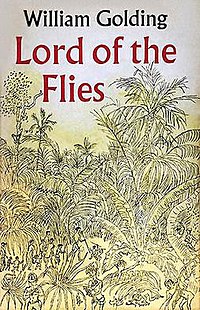 En mettant « l’élève au centre de l’école » au lieu du maître, on renvoie l’enfant à un état de nature supposé idyllique, que William Golding a mis en scène dans son roman « Lord of the flies » : naufragée sur un île déserte, privée de tout référent adulte, la communauté d’enfants retourne à la barbarie en développant les formes de cruauté les plus primaires. La manifestation la plus pathologique du naufrage scolaire est la violence qui « témoigne surtout, en son cœur, d’une désinstitutionnalisation qui fait que les relations entre enseignants et élèves se dégradent en simples interactions, dans lesquelles le sens se construit au fur et à mesure de l’échange des acteurs en présence et non en fonction de normes, de règles, ou de rôles préétablis » Il reste à ce nouvel obscurantisme à couronner son édifice d’une philosophie globale du monde à prétention scientifique: ce sera la tâche du post-modernisme. La force de séduction des pédagogistes est qu’on ne peut dire totalement non à leurs propositions, car il faut effectivement moderniser les processus (la pédagogie). Là où leur démarche dérive c’est en faisant du processus un déterminisme absolu. Arthur Bestor fut élèves d’une des institutions les plus progressistes des Etats-Unis où l’on pratiquait un réel modernisme pédagogique au service de l’acquisition des savoirs. Arrivent alors les pédagogistes qui mettent en place une classe “d’études sociales” :“Je me rappelle avoir été frappé au début par l’infériorité de ce fatras au regard du traitement pur et simple des grandes questions politiques auxquelles mes professeurs d’histoire m’avaient habitué. Les ‘études sociales’ prétendaient jeter de la lumière sur les problèmes contemporains, mais le cours échoua singulièrement, car il n’offrait aucune perspective sur les questions qu’il soulevait, aucune base pour l’analyse soigneuse, aucun encouragement pour la pensée méthodique. On ne manquait pas de discuter, mais ça n’était guère une discussion responsable. Des opinions rapides et superficielles, et non un jugement critique et mesuré, étaient à l’honneur. La liberté de penser était évincée par la liberté de ne pas penser et une endoctrination non dissimulée menaçait par-dessus tout. Je suis surpris de voir avec quelle lucidité nous avions évalué le cours. Je ne peux pas mieux dire que le surnom que nous lui avions alors donné ‘le ragoût social’ (social stew). » Bestor A.E., Educational Wasterlands, The Retreat from Learning in Our Public Schools, Urbana, The University of Illinois Press, 1953, p.46.
En mettant « l’élève au centre de l’école » au lieu du maître, on renvoie l’enfant à un état de nature supposé idyllique, que William Golding a mis en scène dans son roman « Lord of the flies » : naufragée sur un île déserte, privée de tout référent adulte, la communauté d’enfants retourne à la barbarie en développant les formes de cruauté les plus primaires. La manifestation la plus pathologique du naufrage scolaire est la violence qui « témoigne surtout, en son cœur, d’une désinstitutionnalisation qui fait que les relations entre enseignants et élèves se dégradent en simples interactions, dans lesquelles le sens se construit au fur et à mesure de l’échange des acteurs en présence et non en fonction de normes, de règles, ou de rôles préétablis » Il reste à ce nouvel obscurantisme à couronner son édifice d’une philosophie globale du monde à prétention scientifique: ce sera la tâche du post-modernisme. La force de séduction des pédagogistes est qu’on ne peut dire totalement non à leurs propositions, car il faut effectivement moderniser les processus (la pédagogie). Là où leur démarche dérive c’est en faisant du processus un déterminisme absolu. Arthur Bestor fut élèves d’une des institutions les plus progressistes des Etats-Unis où l’on pratiquait un réel modernisme pédagogique au service de l’acquisition des savoirs. Arrivent alors les pédagogistes qui mettent en place une classe “d’études sociales” :“Je me rappelle avoir été frappé au début par l’infériorité de ce fatras au regard du traitement pur et simple des grandes questions politiques auxquelles mes professeurs d’histoire m’avaient habitué. Les ‘études sociales’ prétendaient jeter de la lumière sur les problèmes contemporains, mais le cours échoua singulièrement, car il n’offrait aucune perspective sur les questions qu’il soulevait, aucune base pour l’analyse soigneuse, aucun encouragement pour la pensée méthodique. On ne manquait pas de discuter, mais ça n’était guère une discussion responsable. Des opinions rapides et superficielles, et non un jugement critique et mesuré, étaient à l’honneur. La liberté de penser était évincée par la liberté de ne pas penser et une endoctrination non dissimulée menaçait par-dessus tout. Je suis surpris de voir avec quelle lucidité nous avions évalué le cours. Je ne peux pas mieux dire que le surnom que nous lui avions alors donné ‘le ragoût social’ (social stew). » Bestor A.E., Educational Wasterlands, The Retreat from Learning in Our Public Schools, Urbana, The University of Illinois Press, 1953, p.46.